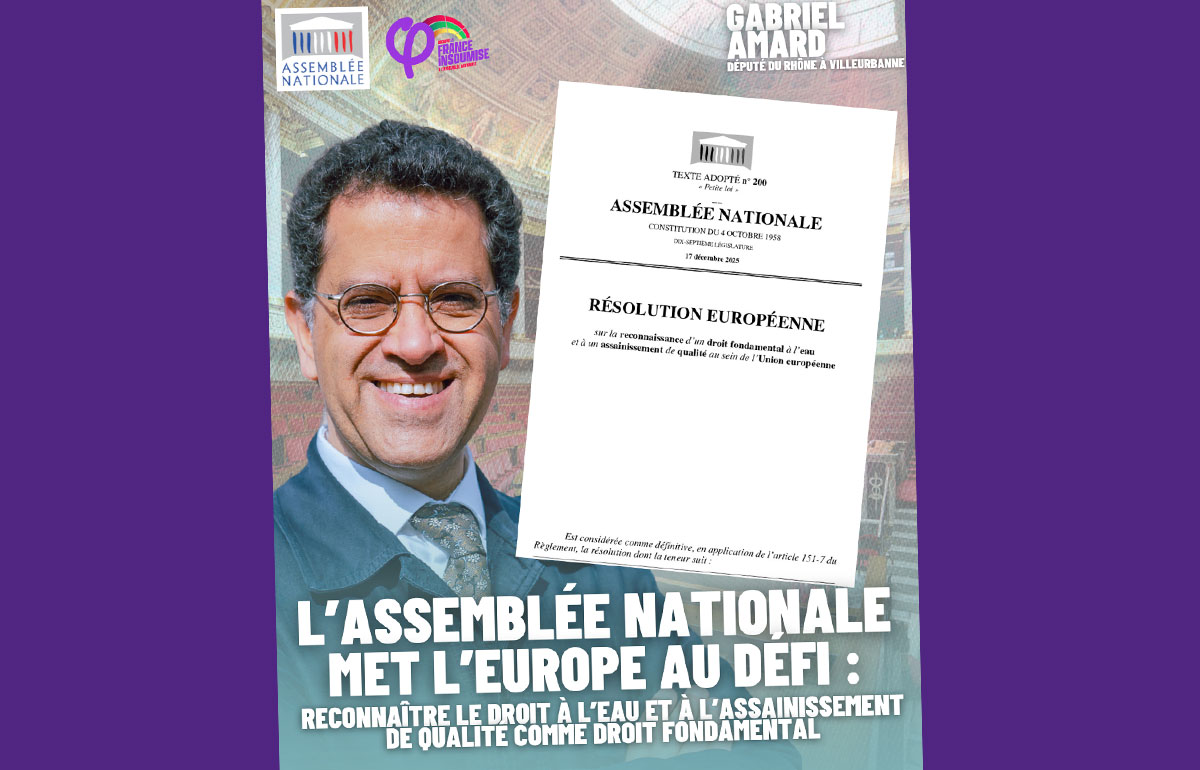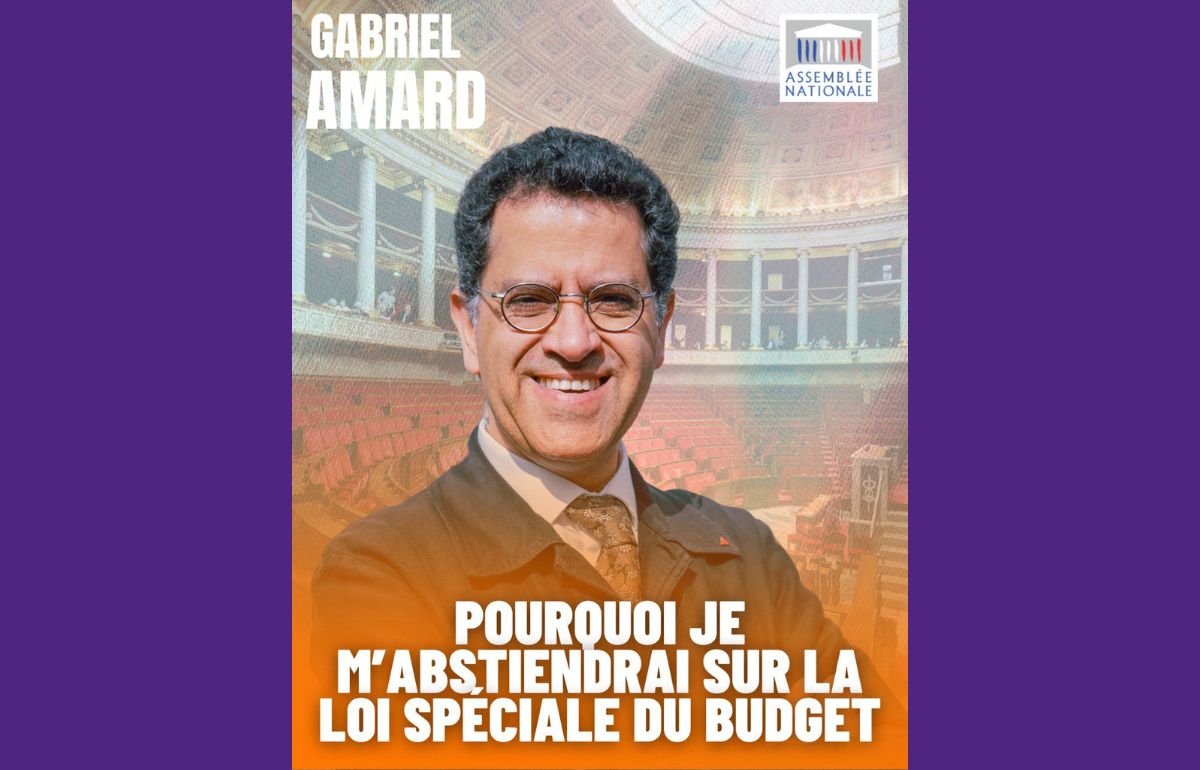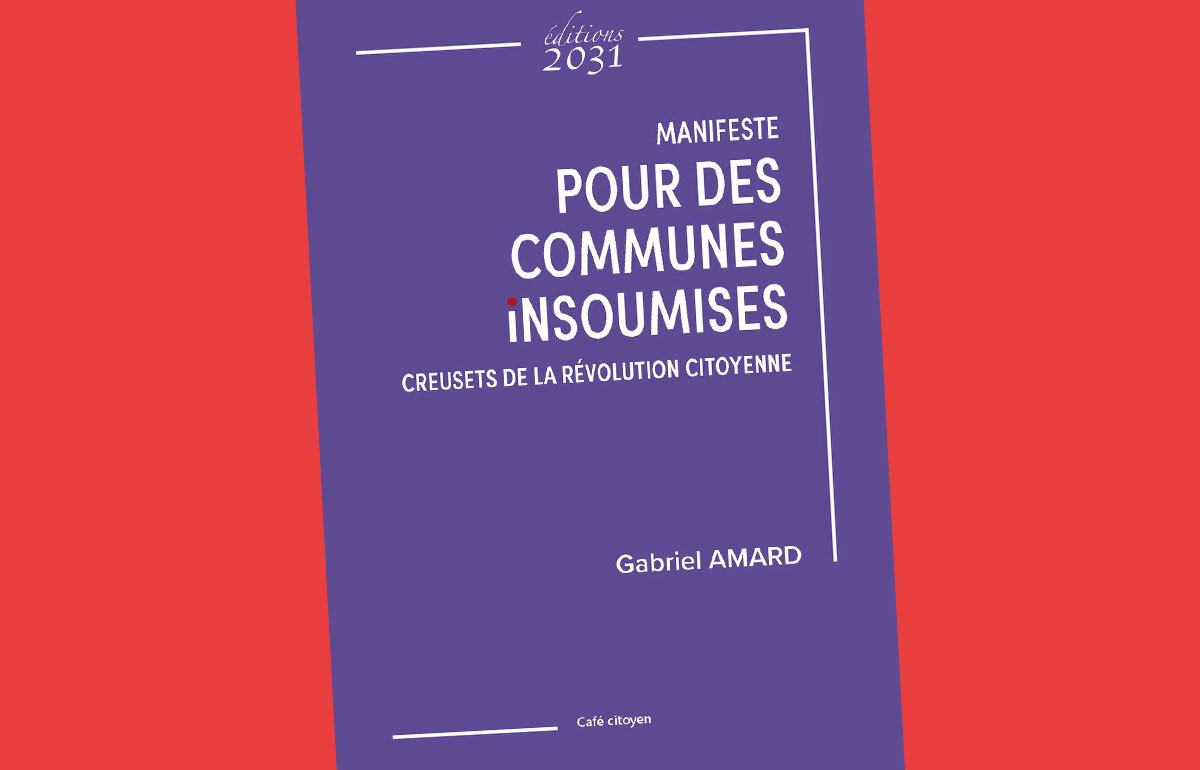Nous déposons avec mes collègues insoumises Ersilia Soudais et Sylvie Ferrer un texte qui s’attaque à l’un des grands angles morts de la transition écologique : le modèle de construction hérité du XXᵉ siècle, celui du béton-roi, de l’extractivisme et de la dépendance aux multinationales des matériaux.
Pendant des décennies, la commande publique a été livrée à une logique industrielle, standardisée, énergivore, qui a contribué à détruire nos paysages, à épuiser nos ressources naturelles et à émettre massivement du CO₂. Le secteur du bâtiment et construction, rappelons-le, représente près de 33 % de nos émissions de gaz à effet de serre et consomme plus de la moitié des matières premières extraites chaque année en Europe.
Cette proposition de loi veut rompre avec cette spirale en favorisant les filières locales et naturelles de construction : le bois, la terre crue, la paille, le chanvre, la pierre sèche — ces matériaux issus de notre patrimoine commun, porteurs d’emplois locaux, de savoir-faire artisanaux et de durabilité.
Un modèle économique et écologique à réinventer
Il ne s’agit pas d’un retour au passé, mais d’un saut qualitatif vers l’avenir.
Ces filières sont déjà à l’œuvre dans nos territoires : elles créent des emplois non délocalisables, soutiennent les artisans, réduisent les coûts énergétiques et réinjectent de la valeur ajoutée dans les circuits locaux.
Leur développement est entravé par une réglementation technique obsolète, taillée pour les grands groupes industriels. En défendant cette proposition, nous voulons ouvrir les normes du bâtiment à l’innovation écologique et populaire, pour que le bois, la terre et la paille cessent d’être marginalisés au profit du béton et du plastique.
Une politique publique de la construction au service du commun
Notre devoir, c’est de garantir que chaque logement, chaque école, chaque bâtiment public soit conçu au service du bien commun et de la biosphère.
Construire avec des matériaux naturels, c’est construire avec sobriété.
C’est préserver la biodiversité et le cycle de l’eau.
C’est aussi remettre la décision entre les mains des élus locaux, des architectes, des citoyens contre les logiques de marché et les contraintes pseudo-techniques qui servent les intérêts privés.
L’État et les collectivités doivent montrer l’exemple : la commande publique doit devenir le levier principal de la transition écologique du BTP. En orientant nos appels d’offres vers les filières locales, nous pouvons créer des dizaines de milliers d’emplois et réduire notre empreinte écologique de façon massive
Pour une planification écologique de la construction
Nous devons sortir de la logique du court terme, du « toujours plus vite, toujours plus rentable ».
Notre pays a besoin d’une planification écologique de la construction, intégrant les savoirs anciens et les innovations contemporaines.
Face au dérèglement climatique et à l’épuisement des ressources, il n’y a pas de neutralité possible : chaque mur bâti, chaque école rénovée doit être un acte de résistance au modèle extractiviste.
Cette proposition de loi n’est pas un texte technique, c’est un choix de civilisation : celui de la durabilité contre l’obsolescence, du local contre le global, du commun contre le privé.
Elle s’inscrit dans la lignée de celles et ceux qui, depuis des générations, ont fait de l’architecture un art de vivre en harmonie avec le vivant.
Gabriel Amard
Lien vers la proposition de loi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1884_proposition-loi.pdf