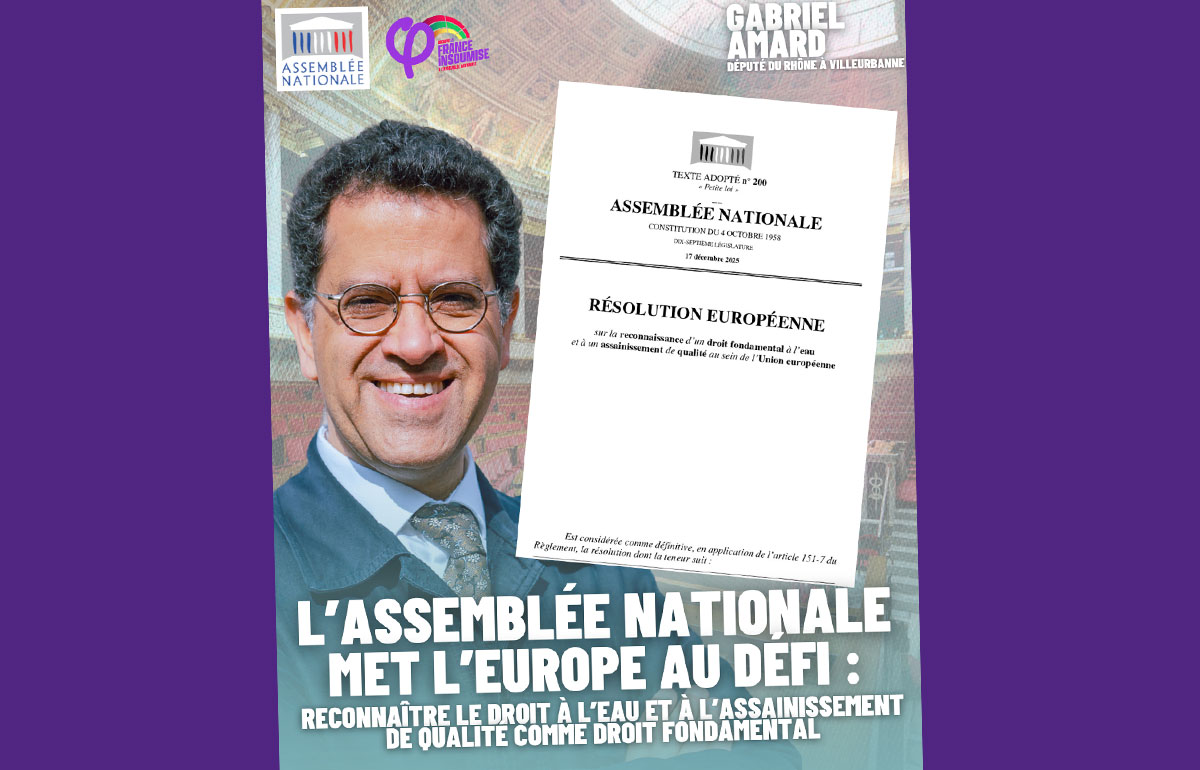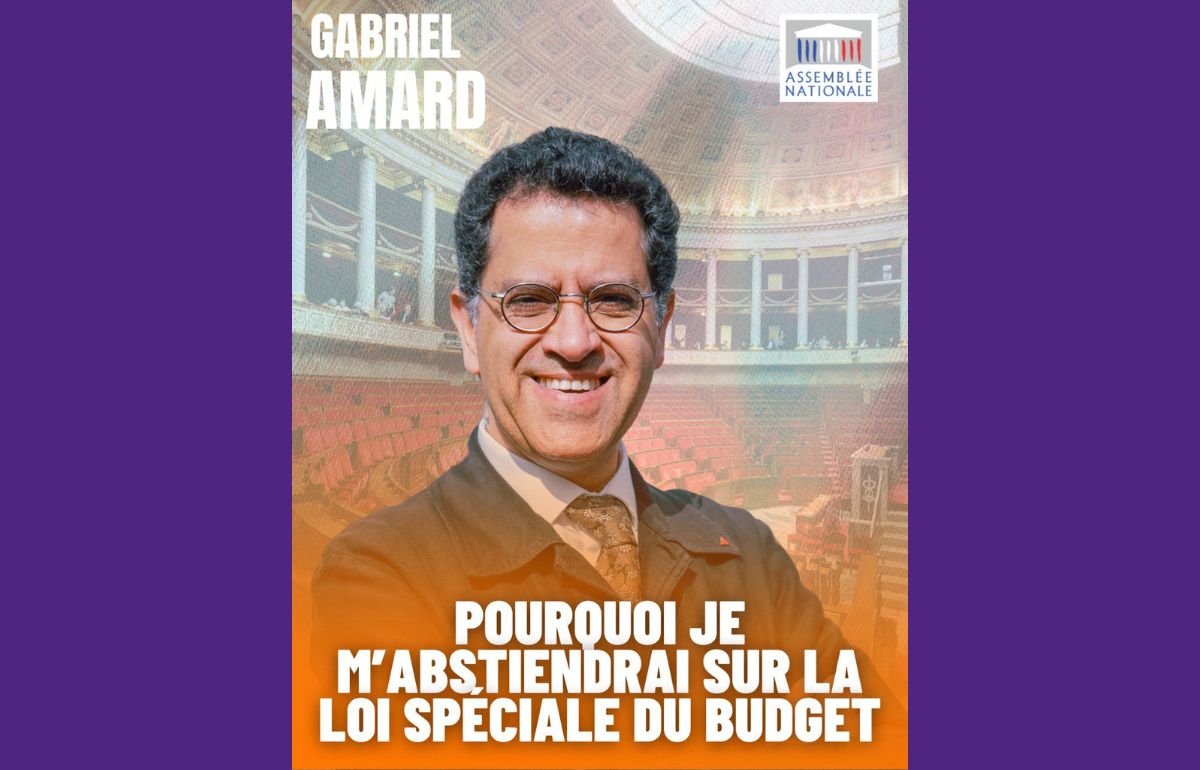10 novembre, 11h31 : les femmes travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année
Chaque année, la même honte recommence.
Ce 10 novembre 2025, à 11h31 et 22 secondes, les femmes de notre pays commencent symboliquement à travailler gratuitement jusqu’à la fin de l’année.
Ce chiffre, révélé par la newsletter Les Glorieuses, dit tout : en moyenne, pour un revenu horaire théorique egal aux hommes, les femmes cessent d’être payées à cette minute précise.
C’est un rappel brutal que, dans la sixième puissance économique du monde, l’égalité salariale reste un mirage.
Une loi bafouée, un principe piétiné
Depuis 1972, le Code du travail proclame que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Et pourtant, rien ne bouge.
Année après année, l’écart stagne.
Les femmes gagnent encore 22,2 % de moins que les hommes dans le privé, 14,2 % à temps égal, et 3,8 % à poste identique.
Même dans la fonction publique, où elles sont 60 % des agents, elles touchent encore 11 % de moins.
Ces chiffres, répétés depuis des décennies, ne sont pas des statistiques abstraites : ce sont des vies, des projets empêchés, des retraites amputées.
Ce sont des mois de travail effacés, des carrières bloquées, des existences sous-évaluées.
L’index « Pénicaud » : un paravent de papier
On nous parle sans cesse de l’« Index égalité professionnelle », mis en place en 2018.
Mais cet outil est un trompe-l’œil.
Il ne concerne qu’1 % des entreprises françaises, permet d’obtenir une note moyenne de 88/100 sans réel progrès, et surtout, il tolère jusqu’à 5 % d’écart sans que cela ne soit considéré comme une inégalité !
Les sanctions ?
Quasiment nulles : 712 mises en demeure et seulement 42 pénalités financières entre 2019 et 2023.
Une mascarade.
La Cour des comptes l’a dit clairement : ce dispositif est « insuffisamment dissuasif ».
On ne corrige pas une injustice structurelle avec des indicateurs comptables.
L’Europe avance, la France recule
La directive européenne de 2023 sur la transparence des salaires impose une révolution de principe : les employeurs devront publier les fourchettes de rémunération, justifier les écarts, et prouver qu’il n’y a pas discrimination.
C’est à eux, désormais, d’apporter la preuve.
C’est un pas en avant.
Mais encore faut-il que la France la transpose avec ambition et non à reculons.
Nous demandons que cette directive soit appliquée rapidement, assortie de sanctions financières et pénales réelles, et qu’elle prenne en compte la discrimination intersectionnelle : celle que subissent les femmes racisées, précaires, ou en situation de handicap.
L’injustice économique totale
L’inégalité salariale n’est qu’un symptôme d’un système profondément inégalitaire.
Une femme sur quatre travaille à temps partiel, souvent contraint.
83 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes.
59 % des personnes au SMIC sont des femmes, tout comme 57 % des travailleurs pauvres.
Elles sont surreprésentées dans les métiers les plus utiles — aide à domicile, santé, nettoyage — mais les moins reconnus, les moins payés, les plus pénibles.
Et quand vient la retraite, les pensions des hommes sont 62 % plus élevées : 75 % des retraités pauvres sont des femmes.
Ce n’est pas une fatalité. C’est une organisation politique du travail.
C’est le résultat d’un système qui exploite la disponibilité, la patience et la culpabilité des femmes, tout en les enfermant dans la précarité.
Une dépendance économique organisée
Parce que le travail féminin reste sous-payé, 75 % des femmes gagnent moins que leur conjoint.
Cela les rend dépendantes, vulnérables, parfois prisonnières.
40 % des familles monoparentales, majoritairement avec des femmes isolées, vivent sous le seuil de pauvreté.
Et même le quotidien devient une charge financière : contraception, protections menstruelles…
Lucile Quillet a calculé que ces dépenses représentent plus de 30 000 euros sur une vie.
Là encore, l’État reste sourd.
Avec les insoumi-es nous demandons la gratuité intégrale des protections périodiques et le remboursement du traitement hormonal de la ménopause.
L’égalité, c’est aussi cela : libérer le corps des femmes de la double peine économique et biologique.
Ce que proposent les insoumis-es
Face à cette chaîne d’injustices, il ne s’agit plus d’« inciter » mais de contraindre.
- Transposer sans délai la directive européenne de 2023, avec de vraies sanctions.
- Réformer l’index d’égalité professionnelle, sur le modèle québécois, en comparant les emplois de valeur égale selon la qualification, la responsabilité, l’effort et les conditions de travail.
- Créer dans chaque entreprise une commission de contrôle salarié sur l’égalité, avec droit de saisine de l’inspection du travail.
- Instaurer une prime compensatoire d’au moins 10 % du salaire brut lorsque l’inégalité est prouvée.
- Revaloriser les métiers « féminisés », reconnaître leur pénibilité, augmenter le SMIC à 1 600 € nets.
- Créer un service public unique de la petite enfance, avec 500 000 places de crèche supplémentaires.
- Abroger le quotient conjugal, instaurer un congé d’accueil obligatoire et identique pour les deux parents.
- Défiscaliser et garantir les pensions alimentaires, et revaloriser l’allocation de soutien familial.
Ce combat est politique
L’égalité salariale n’est pas un supplément d’âme : c’est une question de justice républicaine.
Chaque euro volé à une femme est un euro soustrait à la liberté, à la dignité, à la République elle-même.
Il est insupportable qu’en 2025, dans un pays qui se prétend moderne, les femmes doivent encore quémander ce que la loi leur promet depuis plus d’un demi-siècle.
Nous ne voulons plus de journées symboliques.
Nous voulons la fin de l’injustice.
Comme l’écrivait Simone de Beauvoir, dont la lucidité reste d’actualité :
« Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. »
Le 10 novembre à 11h31, c’est la République elle-même qui cesse de payer ses promesses.
À nous de la rappeler à la justice.